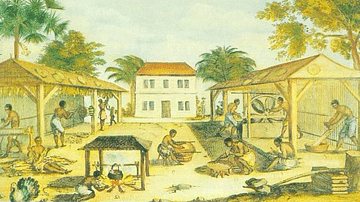Harriet Jacobs (c. 1813-1897) était une ancienne esclave, une abolitionniste et l'auteur de Incidents dans la vie d'une jeune esclave (1861), son autobiographie, qui décrit sa vie d'esclave en Caroline du Nord, sa fuite vers la liberté dans le Nord et les expériences qu'elle y vécut. Son livre fait partie des documents primaires les plus importants sur l'esclavage dans l'Amérique du XIXe siècle.
Jacobs ayant honte de certaines des expériences qu'elle avait vécues en tant qu'esclave, elle choisit de publier son ouvrage sous un nom de plume, Linda Brent, et l'ouvrage fut édité par la célèbre écrivaine et abolitionniste Lydia Maria Child (1802-1880). L'ouvrage fut bien accueilli lors de sa publication et, dans les milieux abolitionnistes en tout cas, Jacobs se vit accorder un grand respect en tant qu'auteur.
Jacobs avait organisé elle-même la publication de l'ouvrage, qui tomba dans l'oubli après 1862. Il ne fut redécouvert que dans les années 1960, avec l'avènement du mouvement des droits civiques et du mouvement des femmes aux États-Unis. Bien qu'initialement reconnu comme une autobiographie, et Jacobs comme son auteur, en 1861, il a été considéré dans les années 60 comme un roman anti-esclavagiste écrit par Child, jusqu'à ce que ce point de vue ne soit corrigé par l'historienne américaine Jean Fagan Yellin (1930-2023).
Aujourd'hui, l'ouvrage est considéré comme égal aux plus grands récits d'esclaves, tels que Récit de la vie de Frederick Douglass (1845) de l'ancien esclave et principal abolitionniste Frederick Douglass (c. 1818-1895) et À 1000 miles de la liberté (1860) d'Ellen et William Craft.
Contrairement à de nombreux autres ouvrages, notamment ceux de Mary Prince (née vers 1788 à 1833), Harriet Tubman (née vers 1822-1913) et Sojourner Truth (née vers 1797-1883) - qui sont des ouvrages de référence - Incidents dans la vie d'une jeune esclave fut écrit par Jacobs et n'a donc pas fait l'objet des critiques formulées à l'encontre des autres ouvrages, considérés comme des exagérations sur les conditions des esclaves par les abolitionnistes.
Jeunesse
Harriet Jacobs était née esclave à Edenton, en Caroline du Nord, vers 1813, fille de Delilah (esclave d'une certaine Margaret Horniblow) et de Daniel Jacobs (esclave d'un certain Andrew Knox). Ses parents firent de leur mieux pour la protéger de la réalité de l'esclavage, comme le note Jacobs:
Je suis née esclave, mais je ne l'ai jamais su avant que six années d'une enfance heureuse ne se soient écoulées [...] J'étais si affectueusement protégée que je n'ai jamais rêvé que j'étais une marchandise, confiée à [mes parents] pour être gardée en sécurité, et susceptible d'être exigée d'eux à n'importe quel moment.
(8)
Jacobs avait un frère cadet, John, et était particulièrement attachée à sa grand-mère, une femme noire libre, Molly Horniblow. Dans sa jeunesse, sa maîtresse, Margaret, lui apprit à lire, à écrire et à coudre. La mère de Jacobs mourut lorsqu'elle avait six ans et Margaret la traita comme sa propre fille. Lorsque Margaret mourut en 1825, elle laissa la jeune Harriet à sa nièce, Mary Matilda Norcom, qui n'avait que trois ans, et c'est le père de Mary, le docteur James Norcom, qui devint le maître d'Harriet. Ce n'est qu'en arrivant à la résidence des Norcom qu'elle comprit qu'elle était une esclave et qu'elle n'avait aucun contrôle sur sa propre vie.
Norcom, Sawyer et le grenier
Elle arriva chez les Norcom vers l'âge de douze ans (l'année de la mort de son père) et fut laissée tranquille par le Dr Norcom jusqu'à l'âge de quinze ans, lorsqu'il commença à lui faire des avances sexuelles et la menaça de violence si elle n'obtempérait pas. Elle réussit à le repousser, principalement grâce à la présence de sa grand-mère dans le quartier. Molly Horniblow était très respectée par les Blancs de la communauté qui l'avaient aidée à acheter sa liberté en 1828, et le Dr Norcom craignait de s'attirer ses foudres, ce qui lui aurait également fait perdre son statut dans ses cercles sociaux.

Jacobs écrit à ce sujet dans le chapitre V: Les épreuves d'une jeune fille, qui apparaît ci-dessous, et endura l'acharnement de Norcom à partir de 1825 jusqu'à ce qu'elle ne s'enfuie en 1835. Elle se lia d'amitié avec un voisin blanc, l'avocat Samuel Tredwell Sawyer (1800-1865) et, croyant que Norcom la laisserait tranquille si elle était enceinte, entama une relation sexuelle avec Sawyer, qui serait le père de ses deux enfants, Joseph et Louisa.
Ses grossesses n'empêchèrent en rien les avances de Norcom, mais rendirent Mme Norcom furieuse, et la vie de Jacobs devint de plus en plus difficile. Croyant que Norcom vendrait ses enfants à Sawyer si elle n'était plus dans la maison, Jacobs s'enfuit, trouvant d'abord refuge auprès d'une femme blanche avant de s'installer dans le grenier de la maison de sa grand-mère, un espace de 9 pieds (3 m) x 7 pieds (2 m) x 3 pieds (1 m), ce qui l'empêchait de se tenir debout.
Norcom vendit ses enfants à un marchand d'esclaves en leur disant qu'ils seraient vendus quelque part plus au sud, où Jacobs ne les trouverait jamais, mais le marchand, qui connaissait la filiation de Sawyer, les lui vendit et il les envoya vivre avec leur arrière-grand-mère, permettant à Jacobs, dans sa cachette, de les entendre et, à travers des trous dans les murs et le sol, de les voir, bien qu'elle ne puisse pas se dévoiler ou interagir avec eux de quelque manière que ce soit. Elle resta dans le grenier, lisant la Bible et cousant, pendant les sept années qui suivirent.
Fuite vers le Nord et abolitionnistes
Pendant cette période, elle envoya périodiquement des lettres à Norcom, affirmant qu'elle avait fui vers le Nord et, en 1842, elle concrétisa cette idée en s'enfuyant vers le Nord à bord d'un bateau à destination de Philadelphie. Les abolitionnistes qui s'y trouvaient payèrent pour qu'elle continue jusqu'à New York, où elle retrouva sa fille, qui avait été envoyée par Sawyer pour travailler comme domestique. Elle trouva un emploi d'infirmière chez le poète et écrivain Nathaniel Parker Willis (1806-1867) et sa femme, Mary Stace Willis, où elle s'occupa de leur fille Imogen.
En 1843, Norcom arriva à New York pour récupérer Jacobs, qui s'enfuit à Boston où vivait désormais son frère John. À la mort de Mary Stace Willis en 1845, Jacobs retourna chez les Willis pour s'occuper d'Imogen et accompagna Nathaniel en Angleterre pour rendre visite à la famille de sa défunte épouse. Après leur retour aux États-Unis, Jacobs se rendit chez son frère John, qui s'installa à Rochester, dans l'État de New York, et travailla avec des abolitionnistes dans une librairie et une salle de lecture situées au-dessus des bureaux du journal de Frederick Douglass, The North Star. C'est là qu'elle rencontra l'abolitionniste quaker Amy Post, qui fut la première à l'encourager à écrire son autobiographie.
En 1850, elle retourna à New York et fut à nouveau employée comme infirmière chez les Willis, cette fois pour l'enfant de la seconde femme de Nathaniel, Cornelia. En 1852, lorsque la fille de Norcom vint à New York pour tenter de retrouver Jacobs et de la ramener en Caroline du Nord, Cornelia Willis acheta la liberté de Jacobs pour 300 dollars afin qu'elle n'ait plus à craindre d'être à nouveau réduite en esclavage.
Incidents dans la vie d'une jeune esclave
En 1853, Jacobs commença à écrire son livre, en changeant les noms des personnes (elle devint Linda Brent, le docteur Norcom devint le docteur Flint, et Samuel Sawyer devint M. Sands) et en omettant volontairement des noms de lieux et des dates. Elle tenta d'obtenir l'aide de Harriet Beecher Stowe, dont le roman anti-esclavagiste La case de l'oncle Tom était devenu un best-seller, mais Stowe rejeta sa proposition. Jacobs décida alors d'écrire le livre elle-même et termina son manuscrit en 1858.
Le livre fut accepté par les éditeurs Thayer et Eldridge à condition que Jacobs demande à Lydia Maria Child d'écrire une préface. Child accepta et joua également le rôle d'éditrice, suggérant à Jacobs d'inclure davantage d'informations sur les conséquences de la rébellion de Nat Turner en 1831, ce qui devint finalement le chapitre XII: La peur de l'insurrection, un rare récit à la première personne de la vie des Noirs dans les États esclavagistes à l'automne 1831.
Thayer et Eldridge firent faillite avant que le livre ne puisse être publié, et Jacobs acheta les plaques stéréotypées qui avaient été fixées et publia l'ouvrage elle-même en janvier 1861. Le livre fut bien accueilli et Jacobs devint une auteure célèbre et une conférencière de renom sur l'abolition.
Guerre de Sécession et vie ultérieure
Pendant la guerre de Sécession, Jacobs aida les esclaves réfugiés dans les environs de Washington, D.C., et fonda avec sa fille la Jacobs School à Alexandria, en Virginie, dont le personnel était composé d'enseignants et d'administrateurs noirs travaillant avec des élèves noirs. En 1866, Jacobs et Louisa se trouvaient à Savannah, en Géorgie, où elles participèrent à des opérations de secours. L'école avait fermé ses portes en 1865 en raison de la violence des suprémacistes blancs. Le sentiment anti-noir en Géorgie rendait impossible la poursuite de leur travail.

Ils retournèrent au nord et Jacobs resta à nouveau avec la famille Willis, aidant à s'occuper de Nathaniel jusqu'à sa mort en 1867. Elle retourna une fois à Edenton, en Caroline du Nord, et, en 1877, déménagea avec Louisa à Washington, D.C., où elles tinrent une pension de famille jusqu'à la mort de Jacobs, de causes naturelles, le 7 mars 1897.
Avec le temps, le nom d'Harriet Jacobs tomba dans l'oubli, tout comme son œuvre. Incidents dans la vie d'une jeune esclave ne revint à l'attention du public que dans les années 1960 et était considéré comme un roman écrit par Child. Le travail essentiel de Jean Fagan Yellin redonna au livre de Jacobs le statut qu'il avait en 1861, et il est aujourd'hui considéré comme un classique de l'histoire américaine.
Texte
Le texte suivant est extrait de Incidents dans la vie d'une jeune esclave, chapitre V: Les épreuves d'une jeune fille, pp. 26-28 de la Dover Thrift Edition, 2001.
PENDANT les premières années de mon service dans la famille du docteur Flint, j'ai eu l'habitude de partager certaines indulgences avec les enfants de ma maîtresse. Bien que cela me parût tout à fait normal, j'en étais reconnaissante et j'essayais de mériter cette gentillesse en m'acquittant fidèlement de mes devoirs. Mais j'entrais dans ma quinzième année, une triste époque dans la vie d'une esclave. Mon maître commença à me chuchoter des mots grossiers à l'oreille. Jeune comme je l'étais, je ne pouvais pas rester ignorante de leur portée. J'ai essayé de les traiter avec indifférence ou mépris. L'âge du maître, mon extrême jeunesse et la crainte que sa conduite ne soit rapportée à ma grand-mère lui firent supporter ce traitement pendant de nombreux mois.
C'était un homme rusé qui avait recours à de nombreux moyens pour parvenir à ses fins. Tantôt il avait des manières houleuses et terribles, qui faisaient trembler ses victimes, tantôt il affichait une douceur qui, pensait-il, devrait certainement faire baisser la garde. Des deux, je préférais ses humeurs houleuses, bien qu'elles me fissent trembler. Il s'efforçait de corrompre les principes purs que ma grand-mère m'avait inculqués. Il peuplait mon jeune esprit d'images impures, comme seul un monstre infâme pouvait en avoir l'idée.
Je me détournais de lui avec dégoût et haine. Mais il était mon maître. J'étais obligé de vivre sous le même toit que lui, où je voyais un homme de quarante ans mon aîné violer quotidiennement les commandements les plus sacrés de la nature. Il me dit que j'étais sa propriété, que je devais me soumettre à sa volonté en toutes choses. Mon âme se révoltait contre cette tyrannie mesquine. Mais où pouvais-je me réfugier pour me protéger? Peu importe que l'esclave soit aussi noire que l'ébène ou aussi blonde que sa maîtresse. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a pas l'ombre d'une loi pour la protéger contre l'insulte, la violence ou même la mort; tout cela est infligé par des démons qui ont la forme d'un homme.
La maîtresse, qui devrait protéger la victime sans défense, n'éprouve à son égard que des sentiments de jalousie et de rage. L'avilissement, les maux, les vices qui naissent de l'esclavage sont plus nombreux que je ne saurais le décrire. Ils sont plus grands que vous ne voulez bien le croire. Il est certain que si vous croyiez la moitié des vérités qui vous sont dites concernant les millions de personnes sans défense qui souffrent dans cette cruelle servitude, vous, au Nord, n'aideriez pas à resserrer le joug. Vous refuseriez certainement de faire pour le maître, sur votre propre sol, le travail mesquin et cruel que les limiers entraînés et la classe la plus basse des Blancs font pour lui dans le Sud.
Partout, les années apportent à tous assez de péchés et de chagrins; mais dans l'esclavage, l'aube même de la vie est assombrie par ces ombres. Même la petite enfant, habituée à servir sa maîtresse et ses enfants, apprendra, avant l'âge de douze ans, pourquoi sa maîtresse déteste tel ou tel esclave. Peut-être la propre mère de l'enfant fait-elle partie de ces haïs. Elle entend les violents accès de passion jalouse et ne peut s'empêcher d'en comprendre la cause.
Elle apprendra prématurément à connaître les mauvaises choses. Bientôt, elle apprendra à trembler en entendant le pas de son maître. Elle sera obligée de se rendre compte qu'elle n'est plus une enfant. Si Dieu l'a comblée de beauté, celle-ci sera sa plus grande malédiction. Ce qui suscite l'admiration de la femme blanche ne fait qu'accélérer la dégradation de la femme esclave. Je sais que certains sont trop brutalisés par l'esclavage pour ressentir l'humiliation de leur condition; mais beaucoup d'esclaves la ressentent de la manière la plus aiguë et en fuient le souvenir.
Je ne saurais dire combien j'ai souffert en présence de ces torts, ni combien je suis encore peinée avec le recul. Mon maître me rencontrait à chaque instant, me rappelant que je lui appartenais, et jurant par le ciel et la terre qu'il me forcerait à me soumettre à lui. Si je sortais pour prendre l'air, après une journée de labeur inlassable, ses pas me poursuivaient. Si je m'agenouillais près de la tombe de ma mère, son ombre noire me poursuivait jusque-là. Le cœur léger que la nature m'avait donné s'alourdissait de tristes pressentiments. Les autres esclaves de la maison de mon maître remarquèrent ce changement. Beaucoup d'entre eux me plaignirent, mais aucun n'osa m'en demander la cause. Ils n'avaient pas besoin de s'informer. Ils connaissaient trop bien les pratiques coupables qui avaient cours sous ce toit, et ils savaient que le fait d'en parler était une offense qui ne restait jamais impunie.
Je désirais ardemment avoir quelqu'un à qui me confier. J'aurais tout donné pour poser ma tête sur le sein fidèle de ma grand-mère et lui raconter tous mes problèmes. Mais le docteur Flint jura qu'il me tuerait si je n'étais pas aussi silencieuse que la tombe. Alors, bien que ma grand-mère soit tout pour moi, je la craignais autant que je l'aimais. J'avais été habituée à la considérer avec un respect proche de la crainte. J'étais très jeune et j'avais honte de lui dire des choses aussi impures, d'autant plus que je la savais très stricte sur ces sujets.
De plus, c'était une femme d'un esprit élevé. Elle était généralement très calme dans son comportement; mais si son indignation était une fois éveillée, elle n'était pas très facile à étouffer. On m'avait raconté qu'elle avait un jour chassé un Blanc avec un pistolet chargé, parce qu'il avait insulté l'une de ses filles. Je redoutais les conséquences d'une explosion de violence, et ma fierté et ma peur m'empêchaient de parler.
Bien que je ne me sois pas confiée à ma grand-mère, et que j'aie même échappé à sa vigilance et à ses questions, sa présence dans le voisinage me protégeait quelque peu. Bien qu'elle ait été esclave, le docteur Flint avait peur d'elle. Il redoutait ses réprimandes cinglantes. De plus, elle était connue et fréquentait de nombreuses personnes, et il ne souhaitait pas que son infamie soit rendue publique. J'ai eu la chance de ne pas vivre dans une plantation lointaine, mais dans une ville pas si grande que les habitants ignorent les affaires des autres. Aussi mauvaises que soient les lois et les coutumes dans une communauté esclavagiste, le docteur, en tant qu'homme de métier, jugeait prudent de maintenir une certaine apparence de décence.
Oh, que de jours et de nuits de peur et de chagrin cet homme m'a causés! Lecteur, ce n'est pas pour m'attirer de la sympathie que je vous raconte sincèrement ce que j'ai souffert dans l'esclavage. Je le fais pour allumer une flamme de compassion dans vos cœurs pour mes sœurs qui sont encore en esclavage et qui souffrent comme j'ai souffert.
Un jour, j'ai vu deux beaux enfants qui jouaient ensemble. L'une était une belle enfant blanche; l'autre était son esclave, et aussi sa sœur. Lorsque je les ai vues s'embrasser et que j'ai entendu leurs rires joyeux, je me suis détournée tristement de ce beau spectacle. Je prévoyais l'inévitable fléau qui allait s'abattre sur le cœur de la petite esclave. Je savais que ses rires se transformeraient bientôt en soupirs. La belle enfant devint une femme encore plus belle. De l'enfance à la vie de femme, son chemin était fleuri et couvert d'un ciel ensoleillé. Il n'y a pas eu un seul jour de sa vie qui ait été assombri lorsque le soleil s'est levé sur l'heureux matin de ses noces.
Comment ces années s'étaient-elles passées avec sa sœur esclave, la petite camarade de jeu de son enfance? Elle aussi était très belle, mais les fleurs et le soleil de l'amour n'étaient pas pour elle. Elle buvait la coupe du péché, de la honte et de la misère, à laquelle sa race persécutée est contrainte de boire.
Dans ces conditions, pourquoi restez-vous silencieux, hommes et femmes libres du Nord? Pourquoi vos langues vous font-elles défaut pour défendre le droit? Si seulement j'avais plus d'habileté! Mais mon cœur est si plein, et ma plume si faible! Il y a des hommes et des femmes nobles qui plaident pour nous, qui s'efforcent d'aider ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Que Dieu les bénisse! Que Dieu leur donne la force et le courage de continuer! Que Dieu bénisse ceux qui, partout, s'efforcent de faire avancer la cause de l'humanité!