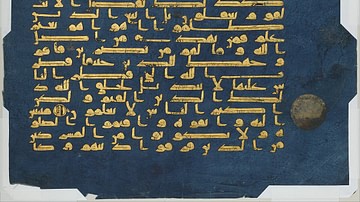La révolution iranienne (1978-1979) fut un mouvement social né d'un mécontentement généralisé et diversifié à l'égard du gouvernement monarchique de l'Iran. La révolution fut menée contre le régime de Mohammad Reza Chah Pahlavi (r. de 1941 à 1979) et aboutit à la fin de la dynastie Pahlavi et à l'établissement de la République islamique d'Iran (1979 à nos jours).
La révolution iranienne résultait des problèmes profondément enracinés qui avaient précédé la dynastie Pahlavi (1925-1979). L'absence de démocratie en Iran, les conditions économiques, l'immoralité religieuse de la monarchie et de la société en général, ainsi que la présence persistante de forces étrangères, suscitaient un profond mécontentement. La révolution constitutionnelle (1905-1907) eut lieu pour exprimer ces mécontentements et protester contre le règne de la dynastie Kadjar (1789-1925). Elle aboutit à la mise en place d'une constitution et du Majlis, un parlement représentatif élu. Cependant, le maintien de la proximité du Chah avec les forces étrangères resta impopulaire et finit par conduire à la disparition des Kadjar et à l'établissement de la dynastie Pahlavi.
Le nouveau chah, Reza Chah Pahlavi (r. de 1925 à 1941), lança un programme de "modernisation" qui serait poursuivi sous le règne de son successeur, Mohammad Reza Chah, malgré la désapprobation des chefs religieux. La dynastie Pahlavi, bien que populaire à certains moments, devint un symbole de l'immoralité occidentale et du sacrilège religieux. Les protestations devinrent monnaie courante dans la société iranienne et la révolution de 1978-1999 aboutit à la création de la République islamique d'Iran.
Révolution constitutionnelle
À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, les intellectuels laïques et le clergé chiite s'opposaient de plus en plus au régime de la dynastie Kadjar, qui, selon eux, ne résisteait pas suffisamment à l'ingérence économique et politique étrangère.
Ce mécontentement conduisit à la révolution constitutionnelle de 1905-1907. Des groupes opposés au règne de Mozaffareddine Chah (r. de 1896 à 1907) menèrent de longues grèves économiques et des manifestations dans la plupart des grandes villes d'Iran. En octobre 1906, une constitution fut rédigée; elle prévoyait des limitations du pouvoir royal et l'introduction d'un parlement représentatif élu (appelé Majlis). Le Chah mourut cinq jours après avoir signé la constitution, le 3 janvier 1907. Avec les lois fondamentales supplémentaires adoptées au début de l'année 1907, qui garantissaient la liberté d'expression, de presse et d'association, la constitution marqua une nouvelle démocratisation en Iran et établit le précédent d'un soulèvement populaire aboutissant à un bouleversement politique couronné de succès.

La dynastie Kadjar finit par être renversée par le coup d'État persan de 1921 en Perse, lorsque l'officier militaire Reza Khan prit le pouvoir à la tête de la brigade cosaque persane. Reza Khan fut placé sur le trône, devenant Reza Chah Pahlavi, le premier monarque de la nouvelle dynastie Pahlavi.
Reza Chah Pahlavi
Les principaux objectifs de Reza Chah Pahlavi étaient de renforcer le gouvernement central et de "moderniser" l'Iran en l'alignant plus étroitement sur l'Europe sur les plans politique, social et économique. Une partie de son programme de "modernisation" consistait à limiter le pouvoir de la hiérarchie religieuse, ce qu'il fit dans de nombreux domaines. Reza Chah créa un système d'éducation laïque, y compris la création d'une université de style européen à Téhéran en 1935, et permit aux femmes d'y participer. Dans un effort plus actif pour limiter le pouvoir de la hiérarchie religieuse, Reza Chah mit en place une codification des lois pour créer un corpus de lois laïques, interdit aux clercs d'être juges et transféra le rôle d'authentification des documents des clercs aux notaires agréés par l'État. En outre, en 1932, un code vestimentaire européen fut mis en place et, en 1936, le port du voile fut explicitement interdit.

Alors que Reza Chah était très populaire, son intolérance à l'égard de la dissidence politique lui aliéna les intellectuels, qui souhaitaient un gouvernement plus démocratique, et les religieux chiites. La police et l'armée devinrent de plus en plus violentes. La rébellion de la mosquée de Goharshad, le 13 juillet 1935, illustra le revirement de l'armée, lorsque les troupes violèrent le caractère sacré du mausolée de l'imam Reza à Mashhad, tuant des dizaines de fidèles qui s'y étaient rassemblés pour protester contre le Chah.
Reza Chah finit par abdiquer le 16 septembre 1941, après l'invasion de l'Iran par la Grande-Bretagne et l'URSS. Son fils lui succéda sur le trône et devint Mohammad Reza Chah Pahlavi.
Pétrole et Mossadegh
L'occupation de l'Iran rapprocha le pays des puissances occidentales sur le plan politique, ce qui renforça le mécontentement de la population à l'égard du gouvernement Pahlavi. La participation de l'Iran à la Seconde Guerre mondiale (1939-45) entraîna une pénurie de nourriture, une forte augmentation de l'inflation et la présence de troupes étrangères qui alimenta la xénophobie et les discours nationalistes. En outre, les membres du Majlis, qui avaient des intérêts patrimoniaux, ne réussirent pas à résoudre ces problèmes, ce qui entraîna une augmentation du soutien au parti communiste Tudeh, qui mobilisait efficacement les travailleurs de l'industrie.
L'exportation la plus rentable de l'Iran, le pétrole, était le catalyseur de l'ingérence étrangère dans le gouvernement. À partir de 1944, les gouvernements soviétique et américain s'affrontèrent dans des négociations pour obtenir des concessions pétrolières de l'Iran, ce qui donna lieu à des attaques de propagande soviétique et à des invasions militaires. Les troupes soviétiques finirent par se retirer en mai 1946, après que le gouvernement eut signé un accord pétrolier avec l'URSS.
En 1948, le désir populaire de nationaliser le pétrole s'accrut en Iran, car il était apparu clairement que le gouvernement britannique tirait davantage de revenus de l'Anglo-Iranian Oil Company que le gouvernement iranien n'en tirait de redevances. Le 15 mars 1951, le Majlis, désormais dirigé par le leader du Front national (et nommé Premier ministre en avril 1951), Mohammad Mossadeq, vote la nationalisation de l'industrie pétrolière.
La popularité de Mossadegh, sa politique anti-occidentale et son intransigeance concernant la nationalisation du pétrole créèrent des frictions entre lui et le Chah. En juin 1953, les États-Unis et le Royaume-Uni unirent leurs forces pour renverser Mossadegh dans le cadre de l'opération Ajax. Le Chah, coopérant avec la CIA américaine, démit Mossadegh de ses fonctions et quatre jours d'émeutes s'ensuivirent, au cours desquels Mohammad Reza Chah quitta le pays. Le 19 août 1953, des unités de l'armée pro-Chah, financées par les États-Unis et le Royaume-Uni, battirent les forces de Mossadegh, le Chah revint en Iran et Mossadegh fut emprisonné.
Une période de répression politique s'ensuivit, Mohammad Reza Chah tentant de concentrer le pouvoir entre ses mains. Les partis nationalistes et communistes furent réprimés, les médias limités, la police secrète (SAVAK) se renforça et les élections furent soigneusement contrôlées.
Mécontentement des religieux
Les religieux chiites étaient de plus en plus mécontents de l'engagement (ou du manque d'engagement) de la dynastie Pahlavi à l'égard de l'islam. Le projet de modernisation mis en œuvre depuis le règne de Reza Chah était constamment critiqué par la hiérarchie religieuse, en particulier l'application de codes vestimentaires européens et l'interdiction du voile, interprété comme un symbole de l'érosion des valeurs islamiques traditionnelles. En 1944, un religieux de rang moyen, Rouhollah Khomeini, publia un livre, Kashf al-Asrar (Secrets dévoilés), qui attaquait le projet de modernisation du Chah et ses politiques anticléricales.
Les débats entre religion et laïcité faisaient partie du paysage politique iranien depuis la révolution constitutionnelle. Ils reprirent de l'importance après l'annonce de la "révolution blanche" de Mohammad Reza Chah en janvier 1963, un programme de modernisation en six points qui comprenait une réforme agraire, la nationalisation des forêts et des pâturages, et la vente des usines publiques à des intérêts privés. Ce programme proposait également d'accorder le droit de vote aux femmes et d'autoriser les non-musulmans à occuper des fonctions officielles, ce que la plupart des religieux chiites jugeaient inacceptable. En juin 1963, celui qui était devenu l'Ayatollah Khomeini fut arrêté à Qom pour avoir prononcé un discours attaquant Mohammad Reza Chah et la "révolution blanche". Son arrestation donna lieu à trois jours de manifestations dans tout le pays, les plus violentes depuis le renversement de Mossadegh dix ans plus tôt; elles furent finalement sévèrement réprimées par le Chah.

En octobre 1964, le gouvernement proposa un projet de loi visant à accorder l'immunité diplomatique au personnel militaire américain en poste en Iran et à leurs familles, permettant ainsi aux Américains de contourner les tribunaux iraniens. Ce projet de loi était profondément impopulaire, en particulier parmi les religieux qui considéraient les États-Unis comme l'incarnation de l'immoralité occidentale. Khomeini, libéré de son assignation à résidence en avril 1964, attaqua le projet de loi devant un large public à Qom. Les enregistrements de ce sermon furent largement diffusés et attirèrent l'attention sur le mouvement religieux anti-Chah. Quelques jours après ce sermon, Khomeini fut à nouveau arrêté et exilé en Turquie; il finirait par s'installer en Irak en octobre 1965.
Depuis son exil, Khomeini continua à publier des déclarations anti-Chah. À la fin des années 1960, Khomeini donna une série de conférences à des étudiants, qui furent ensuite publiées et diffusées sous la forme d'un livre intitulé Velayat-e Faqih (Règle du juriste islamique). Il y affirme que la monarchie en tant que forme de gouvernement est totalement incompatible avec l'islam.
Pendant ce temps, de jeunes Iraniens formèrent plusieurs groupes de guérilla clandestins contre le régime, car l'opposition légale semblait inefficace. La plupart des groupes furent dissous par le régime, mais deux groupes principaux survécurent: les Fedayin (Fedayan-e Khalq), idéologiquement marxistes et anti-impérialistes, et les Moudjahidines (Mujaheddin-e Khalq), qui considéraient l'Islam comme le fondement de leur lutte politique. Les deux groupes utilisaient des tactiques similaires pour saper le régime du Chah: ils attaquaient des postes de police, bombardaient des bureaux américains, britanniques et israéliens, et assassinaient des agents de sécurité iraniens et du personnel militaire américain.
Agitation politique et troubles
En 1976, l'économie iranienne était en difficulté. Le Chah avait tenté d'utiliser l'augmentation des revenus pétroliers après la crise de l'OPEP pour développer l'industrie et l'infrastructure iraniennes au-delà de ses ressources humaines et institutionnelles. Cela provoqua une dislocation économique et sociale généralisée. Dans le cadre du vaste programme de modernisation, le gouvernement utilisa les fonds supplémentaires pour nationaliser les écoles secondaires privées et les collèges communautaires, réduire l'impôt sur le revenu et mettre en œuvre un ambitieux plan d'assurance maladie. Toutefois, ces programmes ne permirent pas de lutter efficacement contre l'inflation ou la flambée des prix de l'immobilier.
En 1978, l'Iran comptait plus de 60 000 étrangers, dont 45 000 Américains, ce qui renforça le sentiment populaire que le programme de modernisation du Chah érodait le caractère iranien du pays ainsi que les valeurs et l'identité islamiques. La répression politique s'accrut en réponse à la montée de la contestation populaire et à l'instauration d'un État à parti unique, ce qui eut pour effet d'aliéner davantage les classes instruites. À partir de 1977, les organisations de défense des droits de l'homme commencèrent à attirer l'attention sur les violations des droits de l'homme en Iran, que le président américain Carter décida de combattre dans le cadre de sa politique étrangère. Le Chah réagit en libérant des prisonniers politiques et en annonçant de nouvelles protections juridiques pour les citoyens. Profitant de cette nouvelle liberté politique, le Front national, le Mouvement pour la liberté en Iran et d'autres groupes politiques recommencèrent à agir et à s'organiser.
Alors que les manifestations de 1977 étaient principalement le fait de la classe moyenne et des laïcs, les manifestations du premier semestre 1978 étaient menées par des personnalités religieuses et bénéficièrent du soutien de groupes plus traditionnels et de la classe ouvrière urbaine. Les manifestants se livraient de plus en plus à une violence calculée; les aspects les plus répréhensibles des régimes étaient pris pour cible. Par exemple, les boîtes de nuit et les cinémas étaient des symboles de la corruption morale et de l'influence occidentale, les banques symbolisaient l'exploitation économique et les postes de police représentaient la violence du régime Pahlavi.
Les slogans et les affiches anti-chah évoluèrent également vers l'utilisation de Khomeini comme visage d'une révolution et comme leader proposé d'un État islamique idéal. Depuis son exil, Khomeini continuait d'appeler à de nouvelles manifestations et mettait en garde contre tout compromis avec le régime. En août 1978, plus de 400 personnes trouvèrent la mort dans un incendie déclenché par des étudiants religieux au cinéma Rex. La popularité du gouvernement s'affaiblit davantage encore à la suite d'une rumeur selon laquelle l'incendie était l'œuvre de la police secrète, et non d'étudiants soucieux de leur religion.
Révolution
Le 4 septembre 1978, à la fin du Ramadan, des manifestations antigouvernementales commencèrent à se répandre en Iran et prirent un ton de plus en plus radical. Le gouvernement déclara la loi martiale à Téhéran et dans 11 autres villes. Le massacre de la place Jaleh eut lieu le 8 septembre, lorsque les troupes de Mohammad Reza Chah tirèrent sur une foule de 20 000 manifestants pro-Khomeini à Téhéran. Le bilan officiel, tel qu'il fut donné par le gouvernement, se situait entre 84 et 122 morts, bien que le chiffre réel soit largement contesté, le nombre étant probablement plus élevé. Ce jour est désormais connu en Iran sous le nom de "vendredi noir" et suscita un mécontentement accru à l'égard du gouvernement.

Khomeini, expulsé d'Irak en 1978, s'installa en France, ce qui permit à son mouvement d'opposition de bénéficier d'une plus grande visibilité dans les médias mondiaux, et la meilleure connexion téléphonique permit d'améliorer la coordination entre les mouvements d'opposition.
En septembre 1978, les travailleurs du secteur public et de l'industrie pétrolière commencèrent à faire régulièrement grève à grande échelle, réclamant de meilleurs salaires et conditions de travail. Ces revendications se transformèrent en appels à un changement politique, le mouvement s'associant à des manifestations plus larges contre le Chah. La pénurie de carburant, de transport et de matières premières conduisit les industries privées à interrompre pratiquement toutes leurs activités dès le mois de novembre. Le Chah, constatant que son emprise sur la société iranienne s'effritait, ferma les écoles et les universités, suspendit les journaux et interdit les réunions de 4 personnes ou plus à Téhéran. Il tenta de ramener la paix en ordonnant la libération de plus de 1000 prisonniers politiques, dont l'ayatollah Hossein Ali Montazeri, un associé de Khomeini. Toutefois, ces capitulations n'eurent pas l'effet escompté. Khomeini dénonça le caractère dérisoire des promesses et appela à la poursuite de la protestation. Les grèves reprirent, ce qui entraîna la paralysie totale du gouvernement.
Les 10 et 11 décembre, des centaines de milliers de personnes participèrent à des marches contre le régime dans tout le pays, ce qui donna lieu à de violents affrontements entre les manifestants et les troupes du Chah. Le Chah entama alors des discussions avec le leader du Front national, Shapour Bakhtiar, qui accepta de former un gouvernement sous la dynastie Pahlavi à condition que Mohammad Reza Chah quitte le pays. Le 3 janvier 1979, le Majlis vota en faveur de la formation d'un gouvernement par Bakhtiar et, le 6 janvier, Bahktiar présenta au Chah son nouveau cabinet. Le 16 janvier, Mohammad Reza Chah fuit l'Iran, et des célébrations éclatèrent dans tout le pays à mesure que la nouvelle se répandait.
Gouvernement Bakhtiar
Le Premier ministre Bakhtiar tenta immédiatement d'éloigner son cabinet du régime du Chah en levant les restrictions imposées à la presse, en libérant tous les prisonniers politiques encore emprisonnés et en promettant la dissolution de la SAVAK. Si ce gouvernement de compromis obtint le soutien des religieux modérés, la plupart des manifestants, menés par Khomeini et les idéologies de gauche, restaient déterminés à mettre fin à la monarchie. Le Front national expulsa Bakhtiar du parti pour avoir capitulé devant le régime Pahlavi, et Khomeini déclara son gouvernement illégal. Le 29 janvier, Khomeini appela à un "référendum de rue" sur la monarchie, ce qui entraîna une manifestation massive de plus d'un million de personnes à Téhéran.
Le 1er février, Khomeini rentra enfin en Iran, où il fut accueilli avec ferveur. Dans un discours prononcé le lendemain, il nomma Mehdi Bazargan premier ministre du gouvernement provisoire. Dans les jours qui suivirent, la loyauté des forces armées envers Bakhtiar diminua et, les 8 et 9 février, l'armée de l'air déclara sa loyauté envers Khomeini. L'arsenal de la base aérienne fut alors ouvert et des armes furent distribuées à la foule. Le 11 février, les hauts commandants militaires annoncèrent la "neutralité" des forces armées, ce qui équivalait essentiellement à un retrait du soutien au gouvernement. En fin d'après-midi, Bakhtiar était en fuite et la capitale tomba aux mains des rebelles: la dynastie des Pahlavi s'effondra.
Suites - Bazargan et le gouvernement provisoire
Par proclamation de Khomeini, Bazargan devint le premier Premier ministre du régime révolutionnaire en février 1979. Cependant, le pays était encore embrasé par le sentiment révolutionnaire, ce qui signifiait que le gouvernement avait peu de contrôle sur la société ou sur sa propre bureaucratie. Depuis la création de centaines de comités révolutionnaires semi-indépendants pendant la révolution, il n'y avait plus d'autorité centrale efficace.

Khomeini ne se considérait pas soumis au gouvernement; il faisait ses propres déclarations politiques, nomma les représentants du gouvernement et mit en place de nouvelles institutions sans Bazargan. Le premier ministre partageait désormais le pouvoir avec le Conseil révolutionnaire, une institution créée par Khomeini en janvier 1979. De nouveaux tribunaux révolutionnaires furent créés pour juger et punir les collaborateurs des anciens régimes. À partir de ce moment, des exécutions d'officiers de l'armée et de la police, d'agents de la SAVAK, de ministres et de députés du Majlis avaient lieu chaque jour. Les brutales activités des tribunaux étaient très controversées et, le 14 mars, Bazargan insista pour que les tribunaux révolutionnaires suspendent leurs activités. Toutefois, le 5 avril, le Conseil révolutionnaire réautorisa les tribunaux. Plus de 550 personnes furent exécutées avant novembre 1979, date à laquelle Bazargan finit par démissionner.
Khomeini, dans ses tentatives d'islamisation de l'Iran, mit en place diverses institutions pour y parvenir, notamment le Corps des gardiens de la révolution islamique, une force militaire loyale aux dirigeants cléricaux qui prit rapidement de l'ampleur. Bazargan était devenu pratiquement impuissant. Un référendum national fut organisé les 30 et 31 mars 1979 pour déterminer le système politique du pays après la monarchie. Cependant, le vote n'était pas secret et il n'y avait qu'une seule forme de système politique sur le bulletin de vote: La République islamique. Le 1er avril, Khomeini déclara la création de la République islamique d'Iran. La constitution fut ensuite réécrite afin d'établir une base pour la domination cléricale et de donner l'autorité ultime à Khomeini en tant que faqîh (connu sous le nom de Guide de la Révolution et d'héritier du Prophète).
Khomeini, les prédicateurs populistes et les partis de gauche attisèrent les flammes d'un sentiment anti-américain déjà largement répandu. En octobre 1979, l'ancien Chah, Mohammad Reza Pahlavi, fut admis pour un traitement médical aux États-Unis, ce qui inquiéta la République islamique, qui craignait que sa maladie ne soit utilisée pour obtenir le soutien des États-Unis à un coup d'État contre la révolution. Après la rencontre de Bazargan avec le conseiller à la sécurité nationale du président américain Carter en Algérie, des centaines de milliers de personnes manifestèrent à Téhéran, certains étudiants "de la ligne de l'imam" occupant l'ambassade des États-Unis et prenant en otage 52 diplomates américains. 2 jours après le début des manifestations, Bazargan démissionna de son poste le 6 novembre 1979. Le Conseil révolutionnaire reprit les fonctions de premier ministre, en attendant les élections présidentielles et celles du Majlis. La crise des otages en Iran dura 444 jours et entraîna la rupture totale des relations entre les États-Unis et l'Iran.